Dietrich Bonhoeffer - Clés de lecture
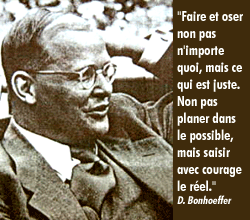
Bonhoeffer naît à Breslau qui aujourd’hui s’appelle Wroclaw et se situe en Pologne. La famille Bonhoeffer est une famille nombreuse de 8 enfants ce qui est plutôt une exception à l’époque. Dietrich et sa soeur jumelle Sabine naissent le 4 février 1906 au foyer de Karl et Paula Bonhoeffer. Un huitième enfant, Suzanne (1909-1991), verra le jour trois ans plus tard. La famille appartient à la grande bourgeoisie et compte parmi ses ancêtres des noms prestigieux. Les Bonhoeffer ont des employés de maison et même un chauffeur. La gouvernante Maria Horn semble avoir joué un rôle important dans l’éducation spirituelle de Dietrich. La mère, Paula, enseignante, assure la première éducation de ses enfants à la maison. C’est elle aussi qui leur donne un enseignement religieux. Toutefois, dans ce milieu de la grande bourgeoisie, on est » chrétien, mais pas pratiquant « . Ainsi, quand la plus jeune sœur de Dietrich, Suzanne, demande à aller au culte, peu de temps après sa confirmation, sa mère lui dit qu’on ne va pas au culte » aussi souvent « .
La musique a une place importante dans la vie de famille. A 12 ans, Dietrich joue des sonates de Mozart au piano et prend part aux concerts que la famille organise à la maison. La maison de Breslau compte plusieurs pièces réservées au jeu, aux études, au bricolage, et même un petit » zoo « . La famille possède aussi une maison de vacances. Dietrich parlera de son enfance comme d’un temps particulièrement heureux et insouciant.
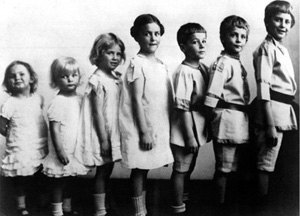
Karl Friedrich (1899-1957), l’aîné, particulièrement proche de Dietrich, devient professeur de physique-chimie. La mort violente de Walter (1899-1918) au cours de la Première Guerre mondiale a beaucoup touché Dietrich comme d’ailleurs toute la famille qui portera longtemps son deuil. Klaus (1901-1945) devient juriste et sera rejoint par Dietrich dans sa lutte contre le régime nazi. Il sera exécuté en même temps que lui. Viennent ensuite deux filles : Ursula (1902-1983) et Christine (1903-1965). La dernière épousera Hans von Dohnanyi qui introduira Bonhoeffer dans les cercles de la conspiration contre Hitler.
Dietrich trouve sa place comme le » grand frère » de Sabine et de Suzanne.
En 1912, suite à la nomination du père comme professeur à l’Université de Berlin, la famille déménage à Berlin, alors capitale de l’Allemagne. En 1916, ils s’installent dans une grande maison à Grunewald. Dietrich n’a aucun problème sur le plan scolaire. Il passe son baccalauréat à 17 ans. Il décide alors, à la stupéfaction de sa famille, d’entreprendre des études de théologie à Tübingen et à Berlin.

La maison des Bonhoeffer dans le quartier Grünewald, à Berlin. Le grand jardin est notamment apprécié parce qu’il permet d’y cultiver des légumes. On élève aussi une brebis pour le lait. En effet, la nourriture manque cruellement à cause de la guerre.

Après avoir obtenu son baccalauréat avec la mention » Très bien « , Dietrich décide de faire des études de théologie. Pour un jeune intellectuel issu de la bourgeoisie, ce choix a de quoi surprendre. Son père écrira plus tard à Dietrich » Lorsque tu t’es décidé pour la théologie, j’ai souvent pensé, en silence, qu’une existence de pasteur tranquille non mouvementée, telle que je l’avais connue chez mes oncles serait presque dommage pour toi. En ce qui concerne la vie non mouvementée je me suis grossièrement trompé « . Seule sa mère semble s’être réjouie de ce choix, elle-même étant issue d’une famille de pasteurs. Grâce aux patients étrangers de son père, psychiatre et professeur de médecine, il est possible de lui payer des études ainsi qu’à trois autres de ses frères et sœurs. Dietrich s’inscrit à Tübingen, et s’intéresse autant aux cours de philosophie qu’à ceux qui sont dispensés en théologie. En 1923, au cours de la semaine avant Pâques, il entreprend un voyage à Rome. Bonhoeffer parlera de cette ville jusque dans ses lettres de prison (qui se trouvent aujourd’hui réunies dans l’ouvrage Résistance et soumission).
Après le deuxième semestre à Tübingen, il continue ses études à la faculté de théologie de Berlin de 1923 à 1927 où il découvre les maîtres de la science historique allemande. Malgré l’aridité et la technicité de l’enseignement, Bonhoeffer s’accroche à ce qui lui est proposé, avec ce goût de l’ordre, de la précision, de la rigueur et de l’achèvement, qui fera de lui, quand il rencontrera le grand désordre du nazisme, justement un révolutionnaire. A 21 ans, il soutient sa thèse de doctorat sur le thème de l’Eglise.
Puis il devient pasteur proposant de la paroisse allemande de Barcelone.
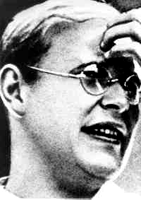
Son frère Klaus accompagne Dietrich au cours de ce voyage offert par leurs parents. Dietrich est émerveillé par cette ville. Tandis que Klaus se passionne pour la ville antique, Dietrich découvre l’Eglise catholique.
Les offices de la Semaine Sainte l’impressionnent. Il participe pratiquement à toutes les célébrations. C’est aussi l’universalité qu’il ressent là. » L’impression est fabuleuse : c’est l’universalité de l’Eglise, avec des Blancs, des Noirs, des Jaunes, tous portant des vêtements ecclésiastiques ; cela semble très idéal « . Les deux frères vont ensuite en Sicile et passent même quelques jours en Afrique. Il semble que Dietrich, au contact de personnes complètement différentes de celles qu’il connaissait jusque-là, se soit beaucoup réjoui de toutes ces impressions nouvelles.
Le catholicisme continuera d’influencer grandement sa réflexion pour les années qui suivront. Dans une lettre à ses parents, il écrit : » Une union [du catholicisme] avec le protestantisme, aussi positive qu’elle puisse être pour les deux parties, est bien exclue. Le catholicisme peut longtemps encore se passer du protestantisme ; le peuple y est fermement attaché et – par rapport aux grandes solennités fêtées ici dans cet espace immense – l’Eglise protestante apparaît souvent comme une petite secte. «
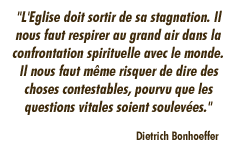
Avant d’occuper officiellement un poste d’enseignant à l’Université de Berlin (à partir du 1er août 1931), Bonhoeffer rencontre la réalité de l’Eglise à plusieurs reprises : à Grunewald, mais aussi pendant une année d’études aux Etats-Unis (1930-1931). Comme Bonhoeffer n’exclut pas de devenir un jour pasteur, il doit rendre compte d’une expérience de travail dans une paroisse. Il choisit donc de s’occuper des enfants de la paroisse de Grunewald bien que lui-même n’ait jamais participé aux cultes organisés pour les enfants dans sa paroisse, sa mère ne le jugeant pas utile. Pour tout enseignement religieux, elle s’était contentée de lui raconter des histoires de la Bible.
Bonhoeffer a un don pour créer des relations avec les enfants. Son groupe ne cesse de grandir. En peu de temps, il faut créer un deuxième groupe pour les filles. Au fur et à mesure que ces enfants grandissent, il les accompagne dans leur parcours jusqu’à organiser des soirées de débat théologique pour les plus grands. Toutes sortes de thèmes y sont abordés et les jeunes se passionnent pour ces discussions ouvertes.
Bonhoeffer n’est pas un théologien de cabinet. Sa théologie se construit au contact des autres, dans la discussion avec ses étudiants, dans la lecture, mais aussi, et de plus en plus, au contact de la situation politique, au contact du monde qui l’entoure. Il parlera dans son ouvrage Ethique de » l’unité polémique de Dieu et du monde « . La foi est un engagement, et on ne peut se taire quand la propagande fait appeler justes et bons des actes inhumains, injustes, contraires au respect de l’être humain. La foi pour Bonhoeffer, appelle à une décision. L’Eglise qui fraie avec les puissants et se compromet avec l’injustice perd sa légitimité. C’est le contexte historique dans lequel il naît -et dans lequel il meurt assassiné- qui forge sa théologie.
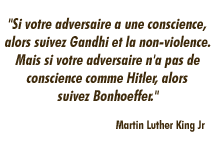
La revendication d’établir l’idéologie nazie dans tous les domaines de la vie privée comme de la vie publique comprend aussi le religieux. Les deux grandes Eglises, protestante et catholique, se voient donc confrontées dès le printemps 1933 au régime nazi. Ses tentatives de » mise au pas » concerneront toutes les organisations religieuses et tous les groupements de jeunesse. Hitler sait qu’il rencontrera de la résistance dans les Eglises. En 1933, 62,7 % de la population allemande est membre de l’Eglise protestante, 32,5 % de l’Eglise catholique.
Les 28 Eglises territoriales qui forment l’Eglise protestante en Allemagne ne sont pas organisées très hiérarchiquement. L’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste est dans un premier temps considérée comme positive par les protestants. Hitler pense donc que la » mise au pas » de l’Eglise protestante est possible. En décembre 1933, les mouvements de jeunesse protestants sont intégrés dans la Jeunesse hitlérienne.
Mais la résistance s’organise. En septembre 1933, le pasteur Martin Niemöller fonde la » Ligue de crise des pasteurs » (le Pfarrernotbund) qui deviendra la base de l’Eglise confessante.
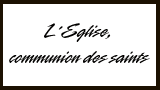
Le sujet de la thèse du jeune étudiant est directement en lien avec les réflexions qui ont accompagné et suivi le voyage de Dietrich à Rome. Qu’est-ce que l’Eglise ? Quelle est son essence ? Dietrich intitule sa thèse L’Eglise, communion des saints. La question de l’Eglise restera essentielle dans la recherche de Bonhoeffer. Elle redeviendra particulièrement actuelle au moment de l’ascension d’Hitler et de la prise de pouvoir des » Chrétiens allemands » dans les organes de l’Eglise officielle. Quelle est alors la » vraie » Eglise ? Quels en sont les critères ?
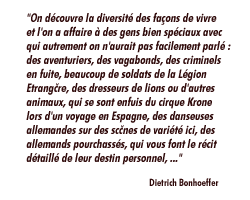
En 1927, sur un simple coup de téléphone, Bonhoeffer part comme pasteur proposant dans la paroisse allemande de Barcelone. Il s’engage dans la réalité de cette paroisse tout en continuant son travail intellectuel. Il portera toujours ce souci de l’articulation entre la réflexion et la pratique. A Barcelone, il fera aussi l’expérience de personnes venant de milieux sociaux défavorisés qui demandent une aide auprès de la paroisse. Toutes les rencontres qu’il fera au cours de ses nombreux voyages vont contribuer à » déparoissialiser » l’homme d’Eglise et » dénationaliser » l’Allemand. En février 1929, il est de retour à Berlin et devient assistant en théologie systématique. Le 10 juin, Adolf von Harnack meurt subitement à Heidelberg. Le 18 juillet 1930, Bonhoeffer soutient sa thèse d’habilitation.

Bonhoeffer rêve de partir en Inde. Ce rêve ne se réalisera pas malgré une invitation de Gandhi en 1936. C’est pour les Etats-Unis qu’il obtient en 1930 une bourse via le Service d’échange universitaire allemand (DAAD). Le voilà donc étudiant àl’Union Theological Seminary de New York. Son amitié avec les Américains Paul Lehmann et Frank Fisher, avec le Suisse Erwin Sutz et le Français Jean Lasserre, le premier pacifiste qu’il rencontre, date de cette année-là. Fisher l’introduit dans les communautés noires. Bonhoeffer découvre leur situation sociale difficile, le racisme jusque dans l’Eglise, mais aussi le chant des Gospels, une tout autre manière de célébrer le culte, des amitiés durables. A la faculté de théologie, il apprécie la plus grande prise en compte de l’actualité dans le travail théologique. Que la lecture de la littérature non-théologique fasse partie intégrante des cours le surprend et le réjouit. En même temps, il constate que la réflexion théologique en souffre du coup quelque peu. Lors de ce séjour, il rencontre aussi une réalité d’Eglise qui le questionne.
Il voyage également à Cuba et au Mexique. On comprend pourquoi, à partir de ce moment-là, la dimension œcuménique au double sens d’interconfessionnel et d’international, est désormais une des constantes de sa vie.
La dimension œcuménique de l’engagement de Bonhoeffer s’accentuera lorsque le nazisme isolera l’Allemagne du reste du monde et isolera l’Eglise en Allemagne. Déjà en 1934, lors de la rencontre oecuménique à Fanö (Danemark), Bonhoeffer, en tant que dirigeant de la délégation allemande des jeunes, prononce un » Discours sur la paix » dans lequel il alerte du danger d’une guerre.
Dans le mouvement œcuménique, Bonhoeffer est un rapporteur rigoureux et infatigable ( » peu commode » disait Visser’t Hooft), réclamant sans cesse la réflexion théologique et la confession concrète de la foi. Il critique la tolérance interconfessionnelle parfois assez fade et la bureaucratie des dignitaires ecclésiastiques. Pendant qu’un prince de l’Eglise prononce un discours quelque peu long et ronflant, Bonhoeffer passe à l’un de ses amis un petit papier avec un vers de Morgenstern » Une large croix sur un large ventre, qui ne sentirait là le souffle de la divinité ? » !

Quand en 1933 l’Eglise est » mise au pas « , Bonhoeffer part à Londres pour s’occuper des deux paroisses de langue allemande. Il y restera jusqu’en 1935. Pendant ce séjour, il reviendra régulièrement à Berlin pour soutenir ses amis dans leur combat contre le régime nazi, se demandant sans cesse s’il ne vaut pas mieux rentrer définitivement. Sa préoccupation transparaît particulièrement dans une prédication du début de l’année 1934, sur un texte du prophète Jérémie. Quand il quitte Londres en 1935, il rejoint l’Eglise confessante et devient le directeur du séminaire de Finkenwalde.
Ce séjour a beaucoup compté pour Bonhoeffer. Il y a tissé des relations durables, en particulier avec l’évêque George Bell qu’il connaissait des conférences œcuméniques mais les deux n’avaient pas encore eu l’occasion de se parler. En l’espace de quelques semaines, Bonhoeffer devient le conseiller de Bell et continue par la suite de l’informer des événements alarmants en Allemagne.
Quand sa sœur jumelle Sabine décide de quitter l’Allemagne avec sa famille, c’est à Londres qu’elle trouvera refuge et que des amis l’accueilleront. Lui-même y reviendra à de multiples reprises pour informer les Eglises sœurs de l’évolution inquiétante de l’Allemagne. C’est aussi dans cette ville qu’il essaiera de trouver un soutien pour le groupe de conspirateurs dont il devient membre.
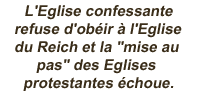
Après la prise de pouvoir du parti national-socialiste en 1933, les Eglises aussi sont menacées de » mise au pas « . Dans l’Eglise protestante, très éparpillée en divers courants, le mouvement des » Chrétiens allemands » s’est déjà formé dès 1930. Il s’agit d’une association de membres d’Eglise qui adhèrent à l’idéologie national-socialiste. Avec l’aide de Hitler, ils ont gagné dès juillet 1933 les élections ecclésiales et ont occupé très rapidement des postes clés de l’Eglise. Seuls les évêques des Eglises régionales de Bavière, du Wurtemberg et de Hanovre n’appartiennent pas aux » Chrétiens allemands « . Depuis la prise de pouvoir en janvier 1933, et avec plus de détermination encore à partir de la victoire des » Chrétiens allemands » lors des élections ecclésiastiques du 23 juin, l’exigence d’introduire le » paragraphe aryen » dans la constitution de l’Eglise divise les esprits. Ce texte exclut du ministère pastoral toute personne ayant de près ou de loin des origines juives. En réaction se constitue la » Ligue de crise des pasteurs » en septembre 1933.
Mais les exigences des » Chrétiens allemands » se faisant toujours plus pressantes (on exige par exemple jusqu’au rejet de l’Ancien Testament considéré comme » trop juif « ), des divisions surviennent au sein même des » Chrétiens allemands » et de nombreux fidèles quittent le mouvement en novembre 1933. Face à cette » Eglise du Reich « , Eglise officielle soumise aux autorités national-socialistes, se constitue un mouvement de résistance qui donnera naissance à l’Eglise confessante. Celle-ci se comprendra comme la » véritable Eglise protestante » en Allemagne et se fonde sur un » droit ecclésial de crise » (Kirchliches Notrecht). Elle refuse la politique de la » mise au pas » du régime nazi, ainsi que » la falsification de la doctrine chrétienne par l’idéologie raciste du national-socialisme « . C’est parce que les membres de l’Eglise confessante refusent leur obéissance à l’Eglise du Reich et à son évêque Ludwig Müller, que la » mise au pas » complète des Eglises protestantes va échouer.

En quelques mois, 7000 pasteurs rejoignent cette Ligue, ce qui représente un tiers des ministres du culte protestant en Allemagne. Elle appelle tous les pasteurs allemands à rejeter le paragraphe aryen, à résister à son application et à aider tous ceux qui sont concernés par lui. Au même moment se constituent dans les Eglises régionales des » communautés confessantes » qui mènent le même combat. La Ligue et ces communautés confessantes vont être à la base de l’Eglise confessante. Elles se dotent d’un organe de direction : le » Conseil des frères » qui coordonne le mouvement confessant. En mars 1934, ce Conseil invite au premier synode qui aura lieu à Barmen du 29 au 31 mai. L’Eglise confessante est née. Elle se considère comme l’Eglise protestante légitime et, par conséquent, elle refuse l’obéissance aux autorités national-socialistes de l’Eglise du Reich. Un texte de six propositions écrit essentiellement par le théologien réformé Karl Barth (1886-1968) et ratifié par le synode devient le fondement théologique de l’Eglise confessante : la Déclaration théologique de Barmen.
Le deuxième synode de l’Eglise confessante à Berlin-Dahlem, les 19 et 20 octobre 1934, s’appuie sur un » droit de crise » légitimant pour les pasteurs le refus de l’obéissance aux autorités nazies.
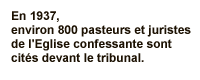
L’Eglise confessante n’a pas considéré son action comme une résistance politique. Mais son existence même et l’affirmation d’opinions contraires au régime suffiront pour qu’elle soit classée par le gouvernement comme » ennemie de l’Etat « . Beaucoup de pasteurs sont menacés, interdits de parole ou bien doivent quitter leurs paroisses. Des membres connus de l’Eglise confessante comme Martin Niemöller, l’évêque régional du Wurtemberg Theophil Wurm (1868-1963) ou encore Otto Dibelius sont arrêtés ou assignés à domicile.
La persécution de l’Eglise confessante et de ses membres se renforce au moment où, en août 1936, est publié un texte anonyme de mise en garde contre Hitler, dénonçant la terreur de la Gestapo, l’existence des camps de concentration et rejetant la vision du monde national-socialiste et l’antisémitisme de l’Etat. Le régime nazi répond par une vague d’arrestations. En 1937, environ 800 pasteurs et juristes de l’Eglise confessante sont cités devant le tribunal.
L’assassinat des juifs a certes été condamné en octobre 1943 par le Synode confessant de la Vieille Prusse, mais il n’y a pas eu de protestations massives. Bonhoeffer n’a cessé de demander à l’Eglise un engagement encore plus clair et décisif envers les victimes du national-socialisme.
Ce silence, partagé aussi par une grande partie de l’Eglise confessante face au génocide, a conduit à la rédaction de la Confession de péché de Stuttgart des 18 et 19 octobre 1945, dans laquelle le Conseil de l’Eglise protestante en Allemagne se déclare co-responsable des crimes du national-socialisme.
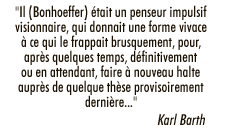
C’est au semestre d’hiver de 1924/1925 que Bonhoeffer découvre la pensée de Karl Barth. Celui-ci enseigne à la faculté de Göttingen et attire de plus en plus d’étudiants. A Berlin, où étudie Bonhoeffer, la pensée de Barth est par contre plutôt critiquée. Cela n’empêche pas Bonhoeffer d’y consacrer beaucoup de temps. Il lit les cours de Barth et également son commentaire à l’Epître aux Romains. En juillet 1931, il passera à Bonn avec le théologien réformé deux semaines au cours desquelles ils confronteront leurs approches.

En mars 1939, Bonhoeffer se rend à Londres chez sa soeur jumelle Sabine qui y a émigré avec toute sa famille. Lors de ce séjour, il rencontre de nouveau l’évêque anglican George Bell. Il le reverra plusieurs fois. Il a pu trouver aupès de lui une écoute disponible et efficace, une relation d’amitié qui l’a soutenu dans son combat.
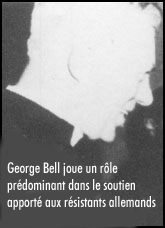
En 1942 en Suède, Dietrich Bonhoeffer rencontre à nouveau l’évêque de Chichester, George Bell (1883-1949) qui joue un rôle prédominant dans le soutien apporté aux résistants allemands. George Bell fait partie de ceux qui réalisent qu’à l’intérieur même de l’Allemagne s’est constituée une résistance qu’il faut soutenir. Comme certains, il partage l’avis que l’après-Hitler peut être envisagé à partir de ces noyaux de résistants. Pour lui, » allemand » n’est pas synonyme de » nazi « . Il connaît désormais trop d’exceptions, Bonhoeffer n’en étant que l’une des plus manifestes. George Bell n’hésite pas à intervenir dans ce sens et à de multiples reprises auprès de son gouvernement. Il le rend attentif aux dangers que court la résistance allemande. Mais le ministère des affaires étrangères britannique poursuit une politique différente : il n’est pas question d’envisager l’après-guerre même avec les résistants actuels au pouvoir nazi sans une capitulation préalable et inconditionnelle de tout l’Etat allemand.

C’est en quittant Londres en 1935 que Bonhoeffer envisage la direction d’un séminaire pastoral de l’Eglise confessante à Düsseldorf. Mais beaucoup de membres de l’Eglise confessante jugent l’endroit trop exposé. On trouve alors un centre de vacances au bord de la Baltique, Zingst, qui accueillera pendant deux mois ce séminaire avant qu’il ne déménage à Finkenwalde, en Poméranie. Bonhoeffer n’est guère plus âgé que ses étudiants. Des relations de confiance s’installent. Les jeux et les promenades rendent agréable le séjour des étudiants. Il faut toutefois faire avec les moyens du bord : pas de chambres individuelles, difficulté de se procurer des vivres… La journée est rythmée par deux longs moments de prière le matin et le soir. Par certains côtés, le séminaire de Finkenwalde ressemble à une communauté religieuse. Mais les étudiants ne sont que de passage. Après six mois d’apprentissage et d’approfondissement en théologie pratique, un autre groupe arrive. Mais Bonhoeffer qui a en tête le modèle de couvents anglicans, aimerait aussi mettre en place une communauté de vie permanente. Après l’accord de l’Eglise confessante, il fonde alors la » Maison des frères » avec six séminaristes qui y demeurent en permanence. En 1937, quand le séminaire est fermé par décret d’Himmler, et que 27 anciens étudiants de Finkenwalde sont arrêtés, Bonhoeffer continue le travail dans la clandestinité. Il partagera ces expériences dans le livre De la vie communautaire. En 1940, le séminaire est fermé pour la deuxième fois.
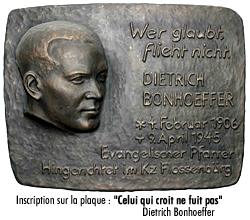
A cause de la menace de guerre en 1939, les amis de Bonhoeffer le font inviter pour un cycle de conférences aux Etats-Unis. Après avoir obtenu par relations le certificat de non-opposition, indispensable pour tout séjour à l’étranger, Bonhoeffer peut partir. Le séjour est prévu pour un an. Toutefois, il ne se sent pas à l’aise dans cette situation. Il se demande sans cesse s’il est juste de fuir, alors que d’autres doivent affronter les folies du régime nazi. Au bout de six semaines, il décide de rentrer. Il prend part alors de plus en plus aux préparatifs d’élimination voir entrée justifier la violence du module Cette violence qui est en nousdu régime et en particulier d’Hitler. Il rejoint alors le groupe de résistants qui s’était déjà formé autour de l’amiral Canaris, chef de l’Abwehr, le service de renseignement interne à l’armée.

C’est en Poméranie que Bonhoeffer fait la connaissance de Maria von Wedemeyer, fille de Hans et Ruth von Wedemeyer. Ils se fiancent en janvier 1943. Mais comme Maria n’a alors que 18 ans, que son père vient de mourir sur le front de l’est, et que de surcroît le contexte est incertain, sa mère demande d’attendre une année avant de rendre publiques les fiançailles et d’envisager le mariage. L’arrestation de Bonhoeffer qui intervient trois mois plus tard bouscule ce qui était prévu. On décide alors d’annoncer sans plus tarder les fiançailles.
Maria rend visite à son fiancé en prison. Mais la plupart du temps, ils n’ont que les lettres pour prendre des nouvelles l’un de l’autre. Cette correspondance figure parmi les textes les plus touchants qui nous sont parvenus de cette période de persécution et de mesures arbitraires, nous la rendant particulièrement proche.

Dietrich Bonhoeffer est arrêté dans l’après-midi du 5 avril 1943. Il est inculpé de » subversion des forces armées » et incarcéré dans la prison militaire de Berlin-Tegel. Sa soeur Christine et Hans von Dohnanyi sont aussi arrêtés. Grâce à sa relation familiale avec le général von Hase (un frère de sa mère) qui intervient pour lui, on le traite avec certains égards. Il jouit ainsi de privilèges que d’autres prisonniers n’ont pas. Toutefois le monde de la prison est bien » un monde d’en bas « , du point de vue duquel, pour Bonhoeffer, il faut regarder la réalité. Le monde des » sans pouvoir, des opprimés et des bafoués, bref de ceux qui souffrent « . Cette observation va nourrir des interrogations existentielles et théologiques profondes. Comment vivre dans ce monde d’en-bas ? Qui est-on dans ce monde ? Comment parler de Dieu dans ce monde ? » Que les Israélites ne prononcent jamais le nom de Dieu me donne encore et toujours à penser, et je le comprends toujours mieux. » La méfiance de Bonhoeffer face à toute forme de » prêt-à-porter » religieux ne cesse de grandir.
Quand les bombardements des Alliés sur Berlin touchent aussi le quartier de la prison miliaire, Bonhoeffer est transféré à la rue Prinz-Albrecht. Il se trouve désormais aux mains de la Gestapo.
A Tegel s’offre à Bonhoeffer une possibilité de fuir. Mais il apprend que la Gestapo cherche à arrêter son frère Klaus. Il décide alors de renoncer à ses projets de fuite pour ne pas mettre en danger davantage sa famille et Maria, sa fiancée. Klaus est arrêté le 1er octobre et le 8 octobre 1944, Dietrich est transféré à la rue Prinz-Albrecht, la prison de la Gestapo tant redoutée. A Tegel, il y avait encore des aumôniers protestants et catholiques, ce n’est plus le cas désormais. On ne sait pas ce que Bonhoeffer a eu à subir comme interrogatoires par les agents de la Gestapo. Il a en tout cas été interrogé sur son rôle dans l’Abwehr. Mais il a pu taire sa participation (et ainsi les noms des autres) à la conspiration. Rüdiger Schleicher et Dohnanyi, les deux beaux-frères de Bonhoeffer, membres de la résistance, sont condamnés à mort le 2 février 1944.
Le lendemain du transfert de Bonhoeffer, une attaque aérienne détruit presque totalement les cachots de la rue Prinz-Albrecht. Les prisonniers sont relogés. C’est ainsi que Dietrich Bonhoeffer se retrouve au camp de concentration de Buchenwald tandis que l’amiral Canaris et Oster (membres comme lui de la conspiration contre Hitler) sont internés à Flossenbürg. Les Américains progressent à l’ouest, l’Armée Rouge occupe d’importantes parties de l’est de l’Allemagne, l’étau se resserre autour du régime nazi qui pressent sa fin. Le 4 avril 1945, un camion emmène les prisonniers d’abord à Ratisbonne où on espère déjà une libération. Mais le lendemain, le 5 avril 1945, un ordre personnel d’Hitler commande l’exécution du groupe de la Résistance de l’Abwehr. Bonhoeffer est conduit à Flossenbürg.
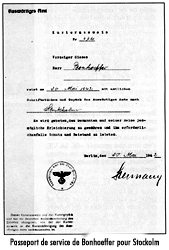
Bonhoeffer s’est demandé à de multiples reprises s’il est possible de transgresser le commandement » Tu ne tueras pas « . Y a-t-il des situations qui justifient le meurtre ? Quels critères pour une telle désobéissance en tant que chrétien ? On trouvera des échos à ces questions dans son ouvrage Ethique qu’il rédige au moment où il rejoint la résistance militaire. En septembre 1940, Bonhoeffer rejoint avec l’aide de son beau-frère Hans von Dohnanyi l’Abwehr (le service de renseignement de l’armée), dirigé par l’amiral Canaris. C’est là qu’il va avoir connaissance des plans visant à liquider Hitler. On lui demande de déménager à Munich pour être moins exposé qu’en restant à Berlin. L’amiral Canaris lui confie des missions à l’étranger soi-disant pour espionner les pays ennemis. Le travail de Bonhoeffer est facilité par les nombreux contacts qu’il entretient déjà dans les réseaux œcuméniques. Comme résistant, son activité centrale consiste à trouver un appui auprès des gouvernements des pays de l’ouest.
Toutefois, il n’est pas facile de faire comprendre aux membres de l’Abwehr qui ignorent le réseau de résistance en leur sein qu’un pasteur travaille désormais parmi des généraux et amiraux. Même si on avance ses relations au plan œcuménique comme moyen » d’espionner l’adversaire « , beaucoup dans ce milieu s’interrogent sur son rôle. Pour lui éviter des questions trop précises de la part de certains des membres du service de renseignement, on le cache chez les bénédictins d’Ettal, non loin de Munich. Il entreprend plusieurs voyages en Suisse, un voyage en Norvège et un autre en Suède pendant lesquels il cherche à convaincre ses correspondants de venir en aide aux résistants de l’Abwehr. Officiellement bien sûr, il ne fait qu’enquêter en territoire ennemi.
Deux tentatives d’attentats échouent le 13 et le 21 mars 1943. Hitler a voulu y voir un » signe divin « . Une vague d’arrestations suit ces tentatives. Bonhoeffer est arrêté le 5 avril 1943, ainsi que son beau-frère Hans von Dohnanyi.
L’attentat à la bombe du 20 juillet manque de peu sa cible. Bonhoeffer l’apprend dans sa prison. Après cette dernière tentative, la Gestapo met la main sur des listes de noms des conspirateurs.
Dans la nuit du 8 au 9 avril, juste avant la libération du camp par les américains, Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris et le général Hans Oster sont condamnés à mort par les SS au terme d’un semblant de procès. C’est à l’aube du 9 avril 1945 qu’ils meurent par pendaison. Une des dernières paroles de Bonhoeffer est » C’est fini. Pour moi, c’est le début de la vie. » Trois autres membres de sa famille seront exécutés dans les jours qui suivent : son frère Klaus (fusillé à Berlin le 23 avril) ses beaux-frères Rudolf Schleicher (fusillé à Berlin le 23 avril) et Hans von Dohnanyi (dans le camp de concentration de Sachsenhausen).
