Dietrich Bonhoeffer - Contexte
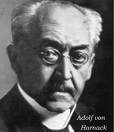
Quand Bonhoeffer apprend la mort subite du professeur Adolf von Harnack, le 10 juin 1930 à Heidelberg, il est profondément touché. Harnack lui avait fait découvrir l’importance d’une recherche historique pour l’étude de la théologie. Mais il avait aussi été un ami, un guide. Lors de la célébration d’adieux à Berlin, le 15 juin 1930, Bonhoeffer est chargé de prononcer le discours d’adieux de la part des étudiants. Il dit : » Grâce à lui, nous avons compris que la vérité ne naît que de la liberté. Nous avons vu en lui le pionnier de la libre expression d’une vérité une fois reconnue, qui formait son libre jugement chaque fois à nouveau et qui, malgré l’appréhension de beaucoup, trouvait chaque fois une claire expression. C’est cela qui faisait de lui un ami de toute la jeunesse qui exprimait son opinion en toute liberté, comme il l’attendait d’elle. Et s’il manifestait son inquiétude ou s’il nous alertait sur les évolutions les plus récentes de notre science, cela s’expliquait exclusivement par la crainte que l’opinion d’autrui ne soit pas respectée en mêlant à la quête authentique de la vérité des éléments extérieurs au sujet. Mais nous savions qu’auprès de lui, nous étions en de bonnes mains ; aussi voyions-nous en lui un rempart contre tout affadissement et toute sclérose, contre toute schématisation de la vie intellectuelle. » Bonhoeffer y exprime déjà que la vérité ne peut naître que dans la libre recherche qui est le contraire des orthodoxies.
George Bell est un théologien anglican, doyen de Canterbury et évêque de Chichester. Il est un des pionniers du mouvement œcuménique. Après 1933, il devient le plus important allié de l’Eglise confessante en Allemagne. C’est principalement Dietrich Bonhoeffer qui l’informe des événements en Allemagne. L’évêque utilise alors sa position dans le mouvement oecuménique pour peser sur l’opinion en Angleterre en faveur de l’Eglise confessante et pour interpeller les autorités nazies à Berlin. Il semble avéré que c’est grâce à son soutien public en faveur du pasteur Martin Niemöller que celui-ci a survécu au régime nazi.
Au cours de l’hiver 1938/39, il aide près de 100 personnes à immigrer en Angleterre. Il s’agit alors de membres de familles de pasteurs, opposants au régime ou de personnes visées par le paragraphe aryen.
Considérant que le bombardement des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale vise trop indifféremment toute l’Allemagne sans prendre en compte les groupes de résistance, les » femmes et enfants innocents « , il dénonce à plusieurs reprises ce bombardement, cherchant en même temps, mais en vain, le soutien du gouvernement britannique.
En novembre 1939, il publie un article dans lequel il demande à l’Eglise » de ne pas hésiter à condamner le bombardement de la population civile. Elle doit se poser contre la propagande de mensonges et de haine. Elle doit être prête à encourager la reprise de relations amicales avec la nation ennemie. Elle doit s’opposer à n’importe quelle guerre d’extermination ou d’asservissement, à toutes les mesures qui visent directement la destruction du moral de la population. » Winston Churchill désapprouve fortement les prises de position de Bell contre le bombardement que l’évêque qualifie de » barbare » : » Comment le conseil de guerre peut manquer de voir que cette dévastation progressive des villes menace les racines mêmes de la civilisation ? »
Après l’attentat du 20 juillet 1944, Bell critique vivement le gouvernement britannique de n’avoir rien entrepris pour aider les résistants allemands.

Immédiatement après l’arrivée au pouvoir de Hitler, le parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) commence par éliminer toutes les organisations qui refusent la soumission absolue réclamée par le parti. La pluralité de la République de Weimar doit être remplacée par l’uniformisation de toutes les institutions de l’Etat et de la société. Le système politique national-socialiste se fonde sur la stratégie de la » mise au pas « , un terme qui a été créé par le ministre de la justice du Reich, Franz Gürtner. En mars et avril 1933, deux lois parlent pour la première fois de la » mise au pas « des » länder » (l’Allemagne était et est encore organisée en régions, les länder, relativement autonomes par rapport au pouvoir central). Sous prétexte de l’unification du Reich, le gouvernement d’Hitler exige la formation de gouvernements régionaux uniquement national-socialistes. Ces lois -contraires à la constitution- permettent de licencier tous les fonctionnaires qui critiquent le régime. Des démocrates, des libéraux, mais aussi et surtout des fonctionnaires juifs perdent ainsi leurs postes. Le paragraphe aryen participe de cette » mise au pas « . Même les plus petites associations de sport ou de chant choral introduisent ce paragraphe dans leurs statuts, avant même que l’Etat ne le leur demande.
La » mise au pas » comprend non seulement des mesures administratives, mais aussi la terreur au quotidien. Grâce aux lois adoptées à la suite de l’incendie du Reichstag (le soir du 27 février 1933) le régime a les mains libres pour lutter contre tous les opposants. Il arrête et déporte d’abord les fonctionnaires du parti communiste (KPD) et du parti social-démocrate (SPD). Du fait de la pression et de la terreur exercées par le parti nazi (NSDAP), et après que le parti social-démocrate ait été interdit, tous les autres partis se défont d’eux-mêmes. A partir de juillet 1933, il n’y a plus qu’un seul parti. Après la mort de Hindenburg (chancelier du Reich) le 2 août 1934, on arrive à une union totale entre le parti national-socialiste et l’Etat. Les deux fonctions de chef du gouvernement et de président du Reich sont désormais réunies dans la personne d’Hitler.
En été 1934, la » mise au pas » des structures les plus importantes a fortement progressé. Le contrôle que peut exercer désormais le parti est devenu quasi total. A côté des associations et organisations, la » mise au pas » concerne aussi la presse, le cinéma et la radio qui deviennent des moyens de propagande. Ce n’est que dans les deux grandes Eglises, catholique et protestante, que ces mesures rencontrent une résistance importante.
Le signe extérieur de la » mise au pas » est la croix gammée. En 1935, elle devient l’emblème de la souveraineté du Reich. Progressivement, le port d’un uniforme s’impose au sein de toutes associations soumises au régime. Il fait partie des signes extérieurs que le régime se donne.

Le père de Dietrich, Karl Bonhoeffer (1868-1948) exerce comme psychiatre à Breslau. A la naissance de Dietrich, il vient d’être nommé directeur de la clinique neuro-psychiatrique. Puis, on l’appelle à Berlin comme professeur de psychiatrie/neurologie. La famille déménage. Son rôle comme expert et juge au tribunal chargé des » affaires eugéniques » l’a vraisemblablement conduit à être responsable d’actes eugéniques (en particulier de stérilisations forcées). Son rôle exact a été vivement discuté et continue de l’être. Certains demandent même que la clinique de Berlin, qui porte son nom, soit débaptisée.
Le » mouvement de foi des chrétiens allemands » naît en 1932 d’un groupement local qui lui-même a vu le jour en 1930 en Thuringe. Le mouvement est organisé d’une manière très hiérarchique selon le principe » Un seul Führer » Les membres se désignent eux-mêmes comme » la SA [=Sturmabteilung, une formation pour la propagande et le combat du parti nazi] de Jésus Christ « . Les » Chrétiens allemands » exigent la » pureté de la race » comme condition pour leurs membres et le rejet par l’Eglise protestante de » toute racine juive « . Lors des élections ecclésiales dans l’Union de la Vieille-Prusse (une des plus grandes Eglises territoriales d’alors), les » Chrétiens allemands » obtiennent en novembre 1932 presque un tiers des voix. Après l’arrivée au pouvoir du parti national-socialiste en 1933, la situation des Eglises en Allemagne change profondément. Hitler s’appuie ouvertement sur les » Chrétiens allemands » pour sa politique à l’égard des Eglises et leur mise au pas selon l’idéologie nazie. Une Eglise du Reich est créée le 23 juillet 1933, et les » Chrétiens allemands » obtiennent deux tiers des voix lors des élections dans les différents synodes des Eglises territoriales. Presque tous les postes importants des Eglises sont désormais occupés par des » Chrétiens allemands « . L’un d’entre eux, Ludwig Müller (1883-1945), qui était jusque-là le responsable auprès d’Hitler pour » toutes les affaires concernant l’Eglise protestante « , devient évêque du Reich (fin septembre 1933) et ainsi le plus haut dignitaire protestant. Quand le Synode de la Vieille-Prusse, dirigé par les » Chrétiens allemands « , introduit début septembre 1933 le » paragraphe aryen » (qui jusque-là concernait les seuls fonctionnaires) pour les pasteurs de l’Eglise, le pasteur Martin Niemöller appelle à résister. Il crée la » Ligue de crise des pasteurs » (le Pfarrernotbund), à partir duquel naîtra peu de temps après l’Eglise confessante.
L’Eglise catholique en Allemagne s’est révélée très critique à l’égard du national-socialisme montant des années 1930-1933. Mais après plusieurs discours de Hitler où celui-ci exprime une attitude positive face à l’Eglise, elle révise sa critique. Son but est désormais la consolidation juridique de ses droits institutionnels particuliers. En avril 1933, le régime nazi prend l’initiative d’un concordat avec le Vatican qui sera signé le 20 juillet.
Dès 1935, beaucoup de membres du clergé catholique qui s’opposent au régime sont victimes d’une campagne de calomnie. Des protestations contre cette campagne de la part de l’épiscopat restent sans réponse. En 1937 le pape Pie XI (1857-1939) publie une encyclique où il se plaint du non-respect du concordat. L’encyclique est lue lors des messes et les persécutions du clergé s’amplifient alors. Certains quittent l’Allemagne pour l’étranger. Quand débute la Deuxième Guerre mondiale, le régime nazi cherche une sorte de pacification des relations avec les Eglises.
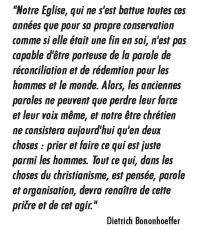
Les persécutions des responsables des Eglises ralentissent au début de la guerre. Mais cette » pacification » ne concerne ni les publications religieuses ni le travail de l’aumônerie aux armées. Toutes les deux rencontrent de nouveaux obstacles. Les Eglises critiquent les actions d’euthanasie du régime. Après les prédications de l’évêque catholique de Münster, Clemens August Graf von Galen, en été 1941, qui se montre critique vis-à-vis du régime, et face aux protestations de la population catholique, les persécutions s’arrêtent officiellement, mais continuent subrepticement. Par contre, les Eglises sont quasiment muettes en ce qui concerne la persécution des juifs. Ni les Lois de Nuremberg de 1935, ni la » Nuit de cristal » du 9 novembre 1938 ne font réagir publiquement les institutions ecclésiales. Même après les premières déportations de juifs allemands dans les camp d’extermination en octobre 1941, on ne rencontre pas de protestation contrairement à ce qui s’est fait lors des cas d’euthanasie. C’est seulement indirectement, par des mots prononcés en chaire ou à travers la » Lettre épiscopale concernant les Droits de l’homme » en mars 1942, que les Eglises condamnent le génocide. Certains chrétiens qui aident les victimes payent leur engagement par l’emprisonnement dans un camp de concentration et parfois par la mort. Après la fin de la guerre, le 23 août 1945, les évêques allemands catholiques ont publié un texte reconnaissant leur culpabilité vis-à-vis des exactions du régime national-socialiste.
Le Conseil de l’Eglise protestante en Allemagne publie les 18/19 octobre 1945 la » Confession de péché de Stuttgart « . Cependant à côté des grandes Eglises existaient en Allemagne plusieurs Eglises libres qui ont été victimes de la terreur nazie.
Dans la nuit du 8 au 9 novembre 1933 ont lieu des pogroms contre les juifs dans toute l’Allemagne. Ils sont menacés, leurs magasins sont détruits, les vitres cassées. C’est pourquoi on a surnommé cette nuit » Nuit de cristal « . Bonhoeffer note cet événement dans sa Bible à côté du verset 8 du psaume 74 : » Leur engeance unanime s’est concertée pour brûler dans le pays tout lieu de rencontre avec Dieu. «
L’initiative du concordat est accueillie par certains avec beaucoup de réticence. Des caricaturistes n’hésitent pas à dénoncer les ambiguïtés d’une telle démarche. Le concordat est signé le 20 juillet 1933. Il signifie la fin de l’influence politique du catholicisme. Mais il garantit à l’Eglise catholique un gouvernement institutionnel indépendant, la continuation des écoles confessionnelles catholiques, la liberté de religion et du témoignage public. Toutefois, dès l’automne 1933, les évêques dénoncent le fait que le régime nazi rompt en permanence le concordat. http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/99006010/index.html
La signature du concordat à Rome, carte postale, Hambourg, 1933. Se trouve dans le Musée d’histoire à Berlin.

Dans sa déclaration lors de sa prise de fonction, Hitler dit aux deux Eglises qu’il les considère comme les » facteurs les plus importants pour le maintien de notre identité nationale (Volkstum) « . Une déclaration qui rassure les uns et inquiète au plus haut point les autres…

Né le 15 mai 1880 à Berlin, Otto Dibelius étudie la théologie protestante auprès d’Adolf von Harnack
Théologien protestant, historien, philologue et éditeur des Pères de l'Eglise, Adolf von Harnack est successivement professeur de théologie à Leipzig, Giessen, Marbourg et Berlin. Il cherche à montrer l'unité entre christianisme et culture et pose " l'Evangile comme seule base de toute culture morale ". (chef de file de la théologie libérale) de 1899 à 1904. En 1906 il est ordonné pasteur. Il exerce à partir de 1910 à Danzig, puis en Poméranie. A partir de 1915, il est pasteur à Schöneberg et devient surintendant général (équivalent d’évêque). En 1925, il participe à la conférence œcuménique de Stockholm. Dans son livre Le siècle de l’Eglise, Dibelius critique la Révolution de novembre 1918, car elle aurait conduit à l’abandon d’un état fondé sur des principes chrétiens. En 1930, Dibelius publie un traité (Paix sur la terre) dans lequel il exige, sur la base d’une conviction chrétienne, que toute guerre soit évitée.
En 1933, et malgré une première sympathie avec le national-socialisme, Dibelius perd toutes ses fonctions. Il s’exile en Italie.
En 1934, il revient à Berlin où il s’engage pour la liberté du culte et l’annonce de Evangile contre les empiétements nazis sur l’Eglise. Deux ans plus tard, il participe au Synode confessant de l’Eglise protestante allemande à Bad Oeynhausen. En 1938, il devient membre directeur de l’Eglise confessante de Prusse. Après la guerre, il rejoint le parti de la CDU (Union démocratique chrétienne) et collabore à la formulation de la Confession de péché de Stuttgart en 1945.
De 1945 à 1966, il est évêque de l’Eglise protestante de Berlin-Brandebourg. Il s’engage dans le mouvement œcuménique. De 1954 à 1960, il est président du Conseil œcuménique des Eglises (COE). A partir de 1961, avec la construction du mur de Berlin, Dibelius entre dans le champ de tension de la Guerre Froide. Il défend la thèse selon laquelle le devoir d’obéissance chrétienne ne s’applique pas à un gouvernement totalitaire comme celui de la RDA. Dibelius meurt le 31 janvier 1967 à Berlin ouest.
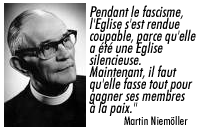
Martin Niemöller naît le 14 janvier 1892 à Lippstadt en Westphalie. Il est fils de pasteur. Son éducation est plutôt nationaliste. Dans la famille, on est fidèle à l’empereur. A 18 ans, il rejoint la marine et devient commandant de sous-marins pendant la Première Guerre mondiale. En 1919, il quitte l’armée et commence des études de théologie. En 1924, il est ordonné pasteur et s’occupe de la Mission intérieure en Westphalie. Quand il arrive en 1931 à Berlin comme pasteur, il rejoint d’abord le parti national-socialiste. Mais au moment où il se rend compte que le parti met en place un régime totalitaire, il prend ses distances et appelle en 1933 à la fondation d’une » Ligue de crise des pasteurs « . C’est d’elle que naîtra plus tard l’Eglise confessante. Niemöller en sera l’un des membres les plus actifs. Avec d’autres responsables d’Eglises, il participe en 1934 à une rencontre avec Hitler. Mais comme il rejette catégoriquement le paragraphe aryen pour des motifs religieux, il doit quitter son poste de pasteur et il est interdit de toute parole publique. Il ne s’y tient pas et continue de prêcher. En 1935, Niemöller est arrêté avec plusieurs centaines d’autres pasteurs qui se sont révoltés contre l’idéologie nazie. Peu après, il retrouve sa liberté jusqu’en juillet 1937 où il est à nouveau arrêté et interné au camp de concentration de Sachsenhausen. En 1941 il est transféré dans le camp de concentration de Dachau où les troupes américaines le libèrent en 1945. Beaucoup de pasteurs et de fidèles ont protesté contre l’arrestation de Niemöller qui est devenu un symbole de la résistance face à la dictature nazie. Il devient en 1945 membre du Conseil des Eglises protestantes en Allemagne (EKD). Dans la confession de péché de Stuttgart, Niemöller défendra la thèse de la culpabilité de l’Eglise protestante vis-à-vis des exactions du national-socialisme. En 1947, il devient président de l’Eglise protestante de Hesse/Nassau. En 1950, il rédige une lettre ouverte au chancelier Konrad Adenauer où il refuse le réarmement. De 1961 à 1968, Niemöller fait partie des six présidents du Conseil Oecuménique des Eglises. En 1972, il reçoit la » médaille Albert Schweitzer de la paix » et en 1982 il est co-fondateur de la » Bibliothèque Internationale de la Paix » à Sarreguemines (Alsace). Il meurt le 6 mars 1984 à Wiesbaden.
