Qu’est ce qui justifie ma vie ?
La justification gratuite est le centre d’une prédication qui annonce non pas la loi Cette notion est essentielle en théologie. Bien qu'elles aient été souvent confondues, il faut distinguer la loi civile qui organise la société et la loi religieuse qui dit ce que l'être humain doit faire pour être agréable à Dieu., mais l’évangile Le mot évangile est un mot grec qui signifie " bonne nouvelle " ou " bon message ". On distingue deux compréhensions.. Contrairement à ce que l’on dit parfois, ce message du salut comprend le salut comme l'action de Dieu qui libère. Le texte de référence est la sortie d'Egypte, la libération de l'esclavage, de l'oppression. gratuit est très difficile à accepter. Il se heurte à des résistances profondes qui tiennent au désir humain d’avoir des titres, de posséder une valeur intrinsèque. Recevoir sans mériter demande une sorte de mort à soi-même à laquelle nous essayons toujours d’échapper. L’être humain se définit souvent et se caractérise par ce qu’il fait. Son activité, ses oeuvres, son travail font de lui ce qu’il est et créent son identité. La justification gratuite contredit un thème essentiel de notre culture, et se situe à contre-courant. Le drame que représente le chômage conduit à se demander si on n’a pas survalorisé le travail ; quelqu’un qui ne fait rien perd-il vraiment sa dignité et sa valeur ?
André Gounelle
- En quoi ce raisonnement vous touche-t-il ou vous questionne-t-il ?
- Qu’associez-vous spontanément à la notion de « gratuité » ?
La justification gratuite est le centre d’une prédication qui annonce non pas la loi Cette notion est essentielle en théologie. Bien qu'elles aient été souvent confondues, il faut distinguer la loi civile qui organise la société et la loi religieuse qui dit ce que l'être humain doit faire pour être agréable à Dieu., mais l’évangile Le mot évangile est un mot grec qui signifie " bonne nouvelle " ou " bon message ". On distingue deux compréhensions.. Contrairement à ce que l’on dit parfois, ce message du salut comprend le salut comme l'action de Dieu qui libère. Le texte de référence est la sortie d'Egypte, la libération de l'esclavage, de l'oppression. gratuit est très difficile à accepter. Il se heurte à des résistances profondes qui tiennent au désir humain d’avoir des titres, de posséder une valeur intrinsèque. Recevoir sans mériter demande une sorte de mort à soi-même à laquelle nous essayons toujours d’échapper. L’être humain se définit souvent et se caractérise par ce qu’il fait. Son activité, ses oeuvres, son travail font de lui ce qu’il est et créent son identité. La justification gratuite contredit un thème essentiel de notre culture, et se situe à contre-courant. Le drame que représente le chômage conduit à se demander si on n’a pas survalorisé le travail ; quelqu’un qui ne fait rien perd-il vraiment sa dignité et sa valeur ?
André Gounelle
Soyez acteur de votre lecture
Dans le texte « Qu’est-ce qui justifie ma vie »:
- Cherchez dans le dictionnaire le mot « salut ». Que découvrez-vous ?
- Le mot salut est-il pour vous, aujourd’hui, compréhensible ? Correspond-il à une notion pertinente ?
- Le texte parle de « résistances profondes » qui font que nous avons du mal à accepter la gratuité. Y a-t-il des situations où vous ressentez ces résistances ?
- La survalorisation du « faire » est-elle liée à une recherche
d’identité,
de dignité,
de profit,
de reconnaissance,
de valorisation ?
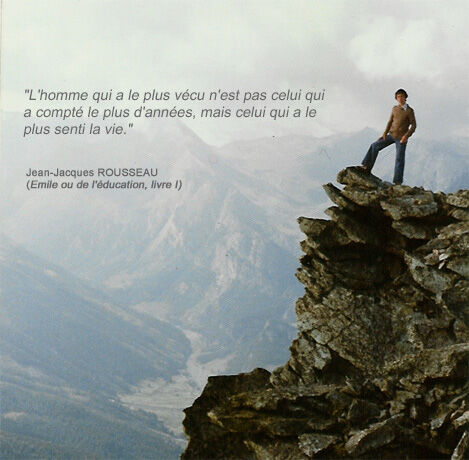
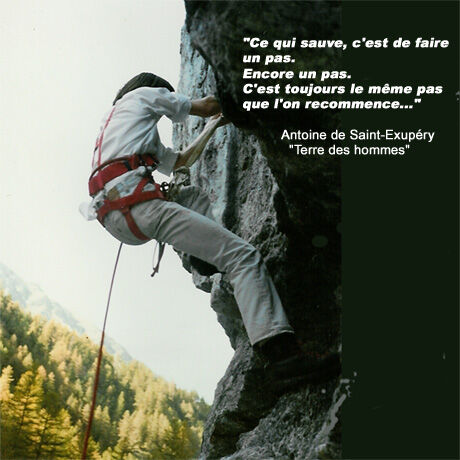

Un peu de culture...
Identité
| Poème de Dietrich Bonhoeffer 1906-1945. Théologien protestant.« | Qui suis-je ? « |
| Qui suis-je ? Qui suis-je ? Souvent ils me disent que de ma cellule je sors détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. |
|
| Qui suis-je ? Souvent ils me disent qu’avec mes gardiens je parle aussi librement, amicalement et franchement que si j’avais, moi, à leur donner des ordres. |
|
| Qui suis-je ? Ils me disent aussi que je supporte les jours de l’épreuve, impassible, souriant et fier, comme quelqu’un qui est habitué à vaincre. |
|
| Suis-je vraiment celui qu’ils disent ? Ou seulement cet homme que moi seul connais ? Inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, Cherchant mon souffle comme si quelqu’un m’étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d’oiseaux, assoiffé d’une bonne parole, de proximité humaine, tremblant de colère au spectacle de l’arbitraire et de l’humiliation la plus mesquine, agité par l’attente de grandes choses, craignant et ne pouvant rien faire pour des amis terriblement loin, trop fatigué et vide pour prier, pour penser, pour entreprendre, las et prêt de tout abandonner ? |
|
| Qui suis-je ? Celui-ci ou celui-là ? Suis-je aujourd’hui celui-ci et demain un autre ? Suis-je les deux à la fois ? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, piteux et méprisable ? Ou bien ce qui est en moi ressemble-t-il à l’armée vaincue, qui fuit en désordre devant la victoire déjà remportée ? |
|
| Qui suis-je ? Ce questionnement solitaire me tourne en dérision. Qui que je sois, Toi, tu me connais : je suis tien, ô Dieu ! |
|
| (Dietrich Bonhoeffer) | |
Un rêve
J’ai fait un rêve. Je cheminais sur une plage côte à côte avec Dieu. Nos pas se dessinaient sur le sable, laissant une double empreinte, la mienne et celle de Dieu. L’idée me vint, c’était un songe, que chaque empreinte représentait un jour de ma vie. Je me suis arrêté pour regarder en arrière. J’ai vu toutes ces traces, elles se perdaient au loin. et en certains points, au lieu de deux empreintes, il n’y en avait qu’une. J’ai revu le film de ma vie. et à ma grande surprise, les points à empreinte unique correspondaient aux jours les plus sombres de mon existence. Jours d’épreuve et de doute. Jours des questions sans réponse sur les hommes et sur Dieu . Jours d’erreur et d’errance, de solitude et de souffrances, jours de colère et de mauvaise humeur. Jours insupportables où moi-même j’avais été insupportable. Alors, me retournant vers Dieu, je lui dis : n’avais-tu pas promis d’être avec moi chaque jour pour m’accompagner ? Pourquoi m’as-tu laissé seul aux plus durs moments de ma vie, seul aux jours où j’aurais eu tellement besoin de toi ? Alors mon Dieu m’a répondu : mon ami, les jours où tu ne vois qu’une seule trace de pas sur le sable sont les jours où je t’ai porté.
(Adémar de Barros, auteur brésilien)
